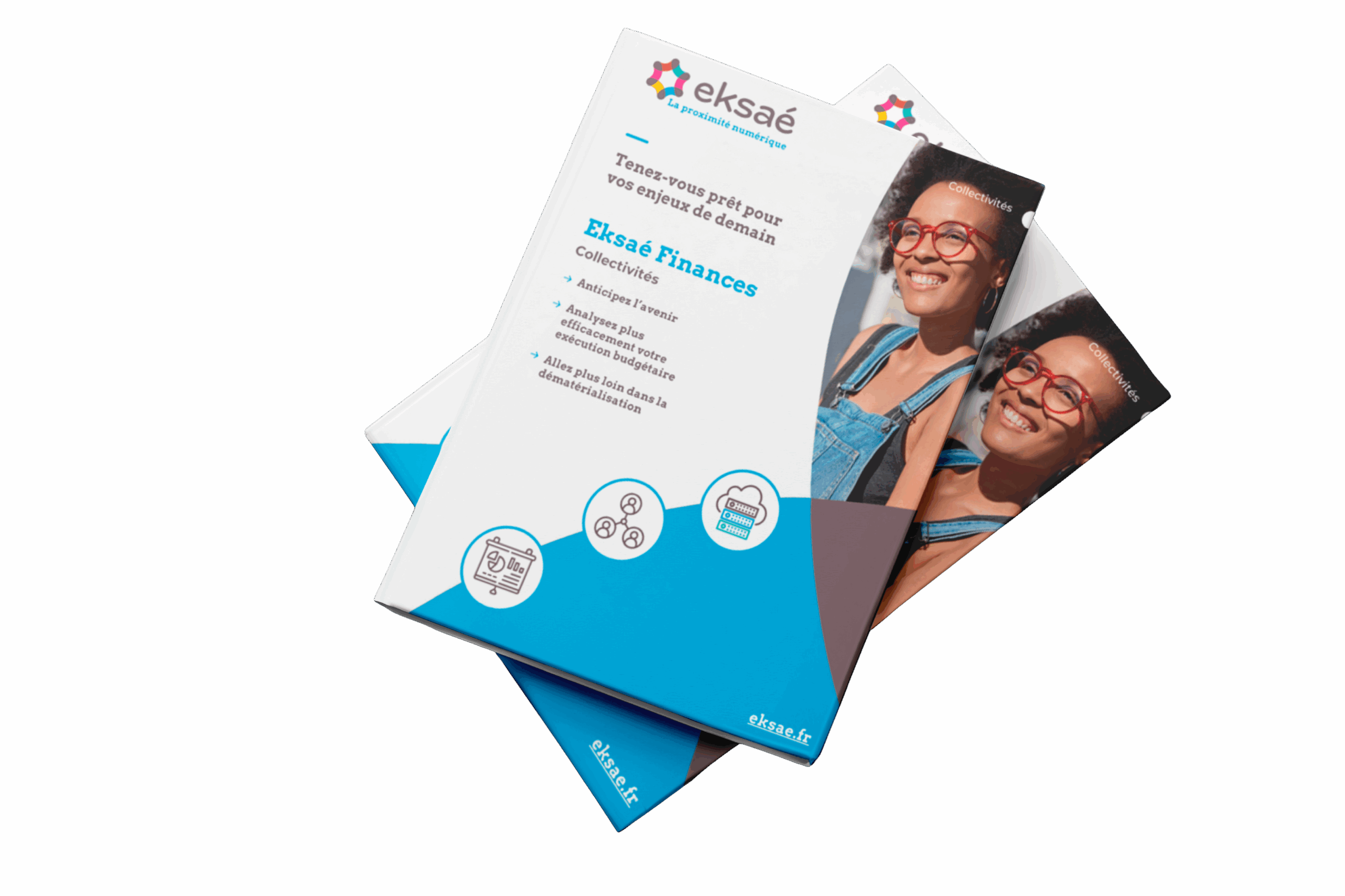Dans un monde de plus en plus conscient des défis environnementaux, le concept de budget vert prend une ampleur considérable. Les gouvernements et les collectivités doivent désormais s’adapter à cette nouvelle réalité. Le budget vert n’est pas seulement une tendance ; c’est un impératif pour garantir un avenir durable. Avec l’échéance de 2026 qui approche, il est crucial d’explorer ce que cela implique pour le secteur public.
Enjeux du budget vert pour le secteur public
Le budget vert représente une opportunité incontournable pour le secteur public. Il s’agit d’un levier puissant pour financer des initiatives durables et réduire l’empreinte carbone des collectivités. À travers cette démarche, les gouvernements peuvent engager des ressources vers la transition énergétique.
Les enjeux sont nombreux. D’abord, il faut sensibiliser les acteurs locaux, élus et fonctionnaires, à l’importance de ces investissements verts. La sensibilisation est essentielle pour faire évoluer les mentalités face à ces nombreux défis.
Ensuite, la transparence dans l’allocation des fonds devient primordiale. Les citoyens doivent voir clairement où va leur argent et comment cela contribue à un avenir durable. Cela renforcera leur confiance envers leurs institutions publiques.
Le budget vert doit être aligné avec des objectifs clairs en matière de développement durable. Chaque action entreprise devra contribuer à réduire les inégalités sociales tout en préservant notre planète.
Ainsi, cette approche proactive transforme non seulement la gestion financière mais aussi le rapport entre administration publique et citoyens dans une dynamique de transparence et de respect de l’environnement.
Obligations pour les collectivités en 2026
À partir de 2026, les collectivités locales seront confrontées à des obligations strictes en matière de budget vert. Cela signifie qu’elles devront intégrer des critères environnementaux dans leurs décisions financières.
Ces nouvelles exigences visent à renforcer la durabilité et à promouvoir une gestion responsable des ressources publiques. Les projets financés devront démontrer un impact positif sur l’environnement, que ce soit par la réduction des émissions de CO2 ou par le soutien aux initiatives écologiques.
Les collectivités auront également l’obligation d’établir des indicateurs clairs pour mesurer l’efficacité de leurs actions. Il ne suffira plus d’adopter une approche réactive ; elles devront anticiper les enjeux environnementaux et agir proactivement.
Pour répondre à ces défis, il sera crucial pour les élus et les techniciens d’acquérir de nouvelles compétences. La formation continue deviendra ainsi un atout majeur pour réussir cette transition vers un budget vert efficace.
L’annexe intitulée « Impact du budget pour la transition écologique », qui fait partie de la démarche du budget vert, concerne diverses entités et budgets, avec des conditions spécifiques.
Voici qui est concerné :
Obligation de production de l’annexe environnementale : L’annexe environnementale est une nouvelle annexe au compte administratif ou au compte financier unique, introduite par l’article 191 de la loi de finances pour 2024, afin de mesurer l’impact des budgets locaux sur la transition écologique. Elle s’applique de façon obligatoire aux entités suivantes, à condition qu’elles mettent en œuvre le référentiel budgétaire et comptable M57 et qu’elles comportent plus de 3500 habitants :
- Les communes.
- Les départements.
- Les régions.
- Les groupements et établissements publics locaux à caractère administratif.
- Les caisses des écoles, CCAS et CIAS.
- Les services d’incendie et de secours.
- Les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
- Le Centre national de la fonction publique territoriale.
De plus, la mise en œuvre du compte financier unique (CFU) impose également la généralisation de l’état relatif au budget vert au plus tard en 2026 pour les collectivités, groupements ou établissements qui n’auraient pas encore choisi le régime M57. Pour les régies dotées de la personnalité morale et exclusivement en charge d’un service public industriel et commercial (SPIC), l’application du CFU les amènera à appliquer l’instruction M4 sous l’égide des dispositions budgétaires et comptables des métropoles.
Sont également soumis à cette obligation :
- L’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
- Île-de-France mobilité (qui applique le régime M57).
- L’établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ».
Budgets concernés par l’obligation :
- Tous les budgets principaux et budgets annexes des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de plus de 3500 habitants sont soumis à l’obligation, à condition qu’ils appliquent les instructions budgétaires et comptables M4 et M57.
- L’annexe environnementale doit être produite à l’appui du compte administratif ou du compte financier unique. Elle peut être produite facultativement à l’appui d’autres documents budgétaires (budget primitif, budget supplémentaire, décision modificative).
Possibilité de production facultative :
- Une commune ou un établissement de moins de 3500 habitants peut produire l’annexe de manière facultative, pour ses budgets principaux et annexes, si elle met en œuvre l’instruction budgétaire et comptable M4 ou M57.
- Il est également possible de coter des dépenses non obligatoires, comme les dépenses de fonctionnement, ou d’appliquer la cotation sur un nombre plus étendu d’axes de la taxonomie européenne, même si ce n’est pas encore obligatoire.
Cette absence d’obligation ne signifie pas que l’outil soit inutile. En effet, certains financeurs – État, Région, Europe ou Département – peuvent conditionner l’attribution de subventions liées à la transition écologique (rénovation énergétique, biodiversité, mobilité, etc.) à la présentation d’éléments similaires à cette annexe.
Ainsi, même pour les petites communes, anticiper et structurer un état simplifié des impacts environnementaux de leurs dépenses peut constituer un réel atout. Non seulement cela facilite l’accès à certaines aides, mais cela valorise également l’engagement de la collectivité en matière de développement durable.
Voici les principaux indicateurs et leur évolution :
Nature de l’indicateur
L’indicateur principal est l’impact environnemental des dépenses exécutées, évalué selon trois catégories pour chaque axe de la taxonomie européenne :
- Favorable
- Défavorable
- Neutre Une dépense peut également être identifiée comme « non cotée » si elle n’a pas été évaluée, notamment pour des montants jugés non significatifs ou en l’absence de méthodologie.
Pour la cotation agrégée, le résultat peut être « globalement favorable », « globalement défavorable », « globalement mixte » (si des impacts favorables et défavorables coexistent), ou « globalement neutre ».
Axes de cotation (Taxonomie européenne)
La cotation est basée sur six axes de la taxonomie européenne :
- Atténuation du changement climatique
- Adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels
- Gestion des ressources en eau
- Transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques
- Prévention et contrôle des pollutions de l’air et des sols
- Préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles
Évolution du périmètre de cotation obligatoire
L’obligation de cotation et les axes concernés se mettent en place progressivement, comme détaillé dans le tableau récapitulatif :
-
Exercice 2024 (comptes produits en 2025)
- Budgets concernés : Budgets M57.
-
- Axes obligatoires : Uniquement l’Axe 1 « atténuation du changement climatique ».
-
- Dépenses concernées : Seul l’impact environnemental des dépenses réelles d’investissement exécutées sur des comptes spécifiques est évalué (ex: 2031 « Frais d’études », 2111 « Terrains nus », 21312 « Bâtiments scolaires », 2151 « Réseaux de voirie », etc.).
-
Exercices 2025 et 2026 (comptes produits en 2026 et 2027)
-
- Budgets concernés : Budgets M57 et M4.
-
- Axes obligatoires : Les Axes 1 (« atténuation du changement climatique ») et 6 (« préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles »).
-
- Dépenses concernées : L’obligation s’étend à l’ensemble des dépenses réelles d’investissement exécutées, à l’exclusion du remboursement en capital des annuités d’emprunt.
-
À compter de l’exercice 2027 (comptes produits à partir de 2028)
-
- Budgets concernés : Budgets M57 et M4.
-
- Axes obligatoires : L’analyse de l’impact environnemental des dépenses sera réalisée de manière obligatoire sur l’ensemble des six axes de la taxonomie européenne, sous réserve de la disponibilité des ressources méthodologiques.
-
- Dépenses concernées : L’ensemble des dépenses réelles d’investissement exécutées, à l’exclusion du remboursement en capital des annuités d’emprunt.
Format de présentation
L’annexe se présente sous forme de tableaux : un tableau par axe de la taxonomie européenne et un tableau de synthèse croisant les résultats des cotations. Les données de cotation sont transmises au niveau de granularité le plus fin (nature comptable et rubrique fonctionnelle) via le logiciel TotEM.
Eksaé a mis en place la possibilité de saisir toutes ces informations et de générer les annexes. Des formations sont disponibles sur ce sujet pour vous accompagner dans la mise en œuvre métier.
Obligations pour les opérateurs de l’Etat en 2026
Les opérateurs de l’État sont également soumis à l’obligation de publier un budget vert. Ces exigences visent à intégrer les principes du développement durable dans toutes leurs activités.
Chaque opérateur devra établir une feuille de route claire pour réduire son empreinte carbone. Cela implique la mise en place d’initiatives concrètes, telles que l’amélioration de l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.
La transparence sera également essentielle. Les opérateurs doivent rendre compte publiquement des progrès réalisés vers leurs objectifs environnementaux. Cette démarche vise à renforcer la confiance auprès des citoyens et des parties prenantes.
De plus, ils devront collaborer avec d’autres entités publiques afin de partager les meilleures pratiques et maximiser les synergies. Une approche collective peut mener à un impact bien plus significatif sur l’environnement.
La méthodologie globale pour évaluer l’impact environnemental des dépenses des opérateurs est une déclinaison et une adaptation de celle utilisée pour le budget vert de l’État. Elle vise à apprécier l’impact environnemental des dépenses des opérateurs de l’État.
Voici les éléments clés de cette méthodologie :
-
Principes directeurs
-
- Elle est élaborée en cohérence avec le budget vert de l’État, reprenant sa synthèse pour informer les parlementaires.
-
- La méthodologie de cotation est directement inspirée de celle du budget vert de l’État et des lignes directrices issues de la taxonomie européenne.
-
- Elle a été développée en collaboration avec les autorités compétentes en matière environnementale, notamment les ministères de la transition écologique et de l’aménagement du territoire, ainsi que le Commissariat général au développement durable.
-
Six axes environnementaux d’évaluation
Chaque dépense est évaluée au regard de son impact sur six domaines environnementaux :
-
- Lutte contre le changement climatique : Contribution à la réduction, limitation ou stabilisation des émissions de gaz à effet de serre.
-
- Adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels : Favorise la résilience face aux événements liés au changement climatique.
-
- Gestion des ressources en eau : Contribue à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines.
-
- Économie circulaire, déchets et prévention des risques technologiques : Impacte la transition vers une économie circulaire, la prévention, la réutilisation ou le recyclage des déchets.
-
- Lutte contre les pollutions de l’eau, de l’air et des sols : Favorise la prévention, le contrôle et la résorption de la pollution.
-
- Biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles : Favorise la protection ou la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
-
Quatre cotations possibles pour chaque dépense
Après évaluation sur les 6 axes, une qualification globale est attribuée :
-
- Favorable (Verte) : La dépense a un objectif environnemental principal ou y participe directement (ex: MaPrimeRénov’). Une dépense est globalement favorable si tous les axes sont favorables, ou si au moins un axe est favorable et les autres neutres.
-
- Défavorable (Brune) : La dépense constitue une atteinte directe à l’environnement ou incite à des comportements défavorables (ex: exploration spatiale, artificialisation des sols pour la construction). Une dépense est globalement défavorable si tous les axes sont défavorables, ou si au moins un axe est défavorable et les autres neutres.
-
- Neutre : La dépense n’a pas d’effet significatif sur l’environnement (ex: masse salariale dans la plupart des cas, transferts d’argent). Une dépense est neutre si tous les axes sont cotés neutres.
-
- Mixte : La dépense présente à la fois un ou plusieurs axes favorables et un ou plusieurs axes défavorables (ex: construction d’une ligne ferroviaire, favorable pour le transport, défavorable pour la biodiversité par artificialisation des sols).
-
Dépenses non cotées
Certaines dépenses ne peuvent pas faire l’objet d’une cotation si l’état actuel des connaissances scientifiques ne permet pas d’évaluer de manière consensuelle leur impact environnemental ou si les données disponibles sont insuffisantes (ex: dépenses numériques où l’impact carbone est difficile à comparer à une procédure papier).
-
Double cotation par finalité et par moyen
C’est une spécificité du budget vert des opérateurs.
-
- Cotation par finalité : Apprécie l’impact environnemental de la mission et la dimension stratégique de la dépense.
-
- Cotation par moyen : Apprécie les modalités utilisées pour mettre en œuvre l’action et permet d’identifier des leviers d’amélioration (ex: choisir des matériaux recyclés pour une construction, acheter des véhicules électriques plutôt que thermiques).
-
- Il n’y a pas de consolidation entre ces deux cotations ; elles sont présentées séparément pour identifier les leviers d’amélioration, notamment sur les moyens.
-
Portée de la cotation
-
- La cotation porte impérativement sur les crédits de paiement (CP), car c’est ce qui sera effectivement réalisé.
-
- Il est également possible de coter les autorisations d’engagement (AE) pour un pilotage pluriannuel et stratégique complémentaire.
-
Nomenclature budgétaire par destination
-
- La cotation est fondée sur la nomenclature budgétaire par destination (nomenclature GBCP) que les opérateurs ont l’habitude d’utiliser.
-
- Le niveau minimal de cotation est le rang 3 (sous-sous-destination), mais les opérateurs peuvent aller plus loin (rang 4) si leur nomenclature est plus fine. Si le rang 3 n’est pas disponible, le rang le plus fin de la nomenclature doit être utilisé.
-
- La nomenclature par destination est généralement stable dans le temps, facilitant le travail de mise à jour les années suivantes.
-
Recommandations opérationnelles pour l’élaboration
-
- Dialogue avec les services métiers : L’élaboration du budget vert ne doit pas se faire uniquement par les services financiers ; elle nécessite des échanges avec les services métiers qui ont une connaissance précise des objectifs des dépenses.
-
- Cohérence avec le budget vert de l’État : Vérifier si des dépenses similaires ont déjà été cotées dans le budget vert de l’État pour éviter un travail redondant et assurer la cohérence des données.
-
- Identification des dépenses neutres par convention : Gagner du temps en identifiant d’emblée les dépenses conventionnellement neutres, comme les transferts financiers aux ménages ou la masse salariale (sauf pour les missions spécifiquement environnementales).
-
Déploiement progressif
La mise en œuvre est progressive sur trois paliers pour tenir compte du coût d’entrée :
-
- BI 2026 : Cotation de la totalité des dépenses de la fonction support (obligatoire) plus la moitié du reste des crédits de paiement.
-
- BI 2027 : Cotation des fonctions support plus 75% du reste des crédits de paiement.
-
- À partir du BI 2028 : Cotation totale de 100% des dépenses du budget.
Cette méthodologie permet de présenter un tableau détaillé (modèle de tableau 3) de la cotation par finalité et par moyen pour chaque rang de destination, accompagné de justifications, et de l’inscrire dans une stratégie verte globale de l’organisme.
Il n’est pas nécessaire de faire évoluer votre logiciel ou de prévoir des développements informatiques spécifiques pour la cotation verte à ce stade.
Le tableau de cotation, tel que le modèle de tableau 3 qui sera présenté à l’organe délibérant, est prévu pour être produit « hors système d’information ». De même, il n’y a pas de lien demandé avec les développements liés à l’Info Centre Infino actuellement pour la cotation verte.
Bien que certains opérateurs puissent trouver la cotation des moyens facilitée par l’existence d’une comptabilité analytique ou d’outils de calcul des coûts complets, l’implémentation de la méthodologie du budget vert des opérateurs ne requiert pas de modifications logicielles généralisées ou de nouveaux développements informatiques.